Dépendances 16 - Qualité des prestations: pourquoi ? pour qui ?: Travail social et nouvelle gestion publique
avril 2002
Travail social et nouvelle gestion publique
Jean-Pierre Tabin (professeur à l'Ecole d’études sociales et pédagogiques, EESP, Lausanne)
Les méthodes d’organisation ou de réorganisation de la production aujourd’hui tant vantées ne sont pourtant pas apparues brusquement il y a une quinzaine d’années: elles présentent en effet des similitudes troublantes avec des méthodes d’un autre temps, soi-disant abandonnées, celles inspirées par l’«organisation scientifique» du travail et de la production de Frederik W. Taylor (1865-1915) 1. Comme le taylorisme, sous couvert d’améliorer le sort des salariés, elles visent à renforcer la division du travail et à intensifier le contrôle de la production et des travailleurs.
Effets de mode? Impossibilité de se poser les questions fondamentales sur le sens du travail? Refus de mettre en question un système qui produit des inégalités, de la déviance et de la misère? Il y a sans doute de cela dans cette évolution. Mais, comme le remarque Pierre Bourdieu dans l’ouvrage qu’il a consacré aux Structures sociales de l’économie (Paris: le Seuil, 2000), ce qui est vraiment nouveau, c’est qu’on assiste aujourd’hui à une «conversion» généralisée de la société aux règles de l’économie. La rationalité calculatrice, qui n’a rien de naturelle, tend à devenir universelle.
Cette rationalité, peu à peu, envahit donc tous les domaines, et l’approche économique s’applique désormais à des questions très éloignées de ce champ: partout, il faut être «rentable», il faut se «mettre en concurrence», il faut produire plus et mieux, il faut développer des incitatifs financiers (salaires «au mérite»), etc. Les très nombreuses absurdités de ce système ne font pas dévier les idéologues de l’économie, et même dans une Angleterre qui connaît depuis des années les méfaits de la dérégulation appliquée aux transports publics (le dernier film de Ken Loach, The Navigators, en est une bonne illustration), le gouvernement de Tony Blair continue à la renforcer, en la présentant comme la seule issue possible. C’est pour cela que le terme de «conversion» est particulièrement bien choisi: il n’est pire fanatiques que les convertis.
Les services sociaux dans la tourmente
Du fait de l’inscription des services sociaux dans le cadre du service public, les transformations du rôle de l’Etat les touchent très directement.
Il est sans doute utile de rappeler ici que les crises budgétaires successives des finances publiques, au plan fédéral comme au plan cantonal, ont été provoquées par la volonté délibérée des élus de limiter l’accroissement de l’Etat 2. Différentes réductions d’impôts ont été mises en œuvre et divers projets, visant à réduire encore le revenu de l’Etat, se profilent de nouveau dans les cantons, comme l’initiative libérale visant à supprimer l’impôt sur les successions dans le canton de Vaud (d’autres cantons, comme Zurich, ont déjà récemment supprimé cet impôt). Conséquence de cette politique: un déséquilibre financier de l’Etat.
Pour y remédier, dès les années 1990, les conditions de travail du personnel de l’Etat ont été précarisées (péjoration ou abolition du statut de fonctionnaire, introduction du salaire au mérite) et les objectifs du service public mis en question. Sous couvert de «modernisation», le politique a exigé de l’Etat une «concentration sur ses missions centrales» et un «ciblage des prestations». L’introduction de méthodes managériales de gestion, présentées comme nécessaires ou inévitables, a obligé les services à adopter des concepts de l’économie privée: une planification par objectifs limités dans le temps, une mise en concurrence des services, le tout dans une logique de réduction des dépenses publiques et de légitimation des résultats obtenus. Le document de 1995 des Hospices vaudois, signé de leur directeur de l’époque, est exemplaire de cette «éthique de la parcimonie».

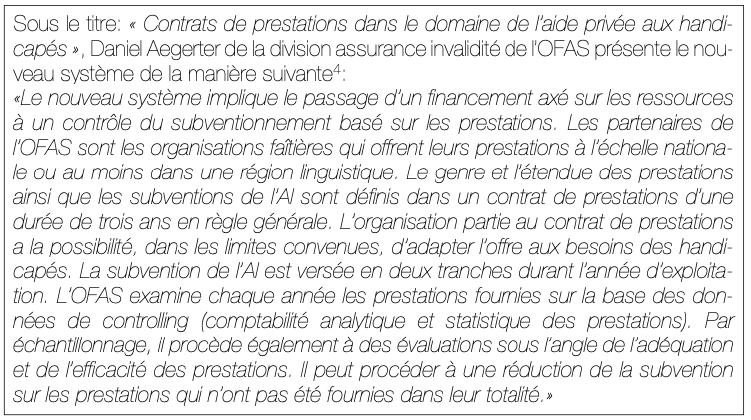
Ainsi les «contrats de prestations», issus du «New public management» (nouvelle gestion publique), s’épanouissent désormais dans des administrations publiques, des hôpitaux, des institutions sociales, dans les offices régionaux de placement, dans des centres sociaux ou médico-sociaux, à Pro Infirmis ou à Pro Senectute. Parfois, l’attribution d’un «contrat de prestation» passe par le marché compétitif (par exemple par la comparaison, ce qu’on appelle de manière quelque peu comique le «benchmarking»).
Les «contrats de prestations», issus de la plus pure raison administrative, obligent à définir des objectifs et des standards explicites, qui sont ensuite concrétisés par des mandats à l’intention des agences de l’Etat.
Les critiques classiques aux contrats de prestations relèvent que les politiques publiques peuvent avoir des objectifs contradictoires, voire parfois seulement politiques. C’est un fait souvent constaté dans un pays comme la Suisse, qui connaît différents niveaux de mise en œuvre de ses politiques (fédéral, cantonal, communal). Ainsi l’article 12 de la Constitution fédérale de 1998, garantissant à chacun le droit de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, n’est pas prêt de trouver une concrétisation uniforme dans les régimes d’aide sociale des différents cantons. Il n’est que d’étudier, pour s’en convaincre, l’extrême diversité des lois actuellement développées pour répondre à cette exigence 3. On peut aussi constater que cet article est interprété de manière tout à fait différente pour les requérants d’asile que pour les autres personnes.
Mais surtout, les contrats de prestations postulent que toutes les activités, y compris sociales ou éducatives, peuvent être calibrées et découpées. Il serait possible, par exemple, de découper et de standardiser les étapes nécessaires pour répondre à une demande de désendettement, comme le faisait Taylor avec les pelleteurs de minerai et de coke en 1899. Pour pouvoir découper une activité avec précision, il faut la réduire à sa plus «simple» expression. En effet, plus un produit est simple, plus il est quantifiable et c’est ce qu’on appelle la «tyrannie des indicateurs». Les pratiques sociales ou éducatives, traditionnellement, reposent au contraire sur différentes théories et savoir-faire qui postulent que la personne doit être considérée dans sa «globalité» et qu’un travail social et éducatif ne prenant pas en compte les multiples dimensions de son développement est voué à l’échec.
Obliger à simplifier les pratiques sociales ou éducatives en les transformant en prestations, c’est imposer une dévalorisation de toutes les activités complexes et une démotivation du personnel et de l’institution à les affronter, parce que cela ne rapporte pas (ou pas assez) de «points». C’est aussi risquer «de «produire des produits pour produire des produits», et non pas pour résoudre des problèmes. On court après des produits simples et quantifiables pour justifier le budget, tout en perdant de vue la finalité de la démarche» 4. C’est enfin une approche qui risque fort d’être vouée à l’échec: un comptable, sans doute capable de proposer une gestion rationnelle de ses dettes à une personne endettée, ne peut comprendre et permettre de modifier le comportement (peut-être irrationnel) qui a conduit la personne à se ruiner.

Les contrats de prestations et les démarches analogues font en outre l’impasse sur le fait que l’emploi est une activité hautement complexe, «par le décalage irréductible entre l’organisation prescrite du travail et l’organisation réelle […]. Il est impossible, dans les situations ordinaires de travail, d’atteindre les objectifs de la tâche si l’on respecte scrupuleusement les prescriptions, les consignes et les procédures… Si l’on s’en tenait à une stricte exécution, on se trouverait dans la situation bien connue de la grève du zèle. Le zèle, c’est précisément tout ce que les opérateurs ajoutent à l’organisation prescrite pour la rendre efficace; tout ce qu’ils mettent en œuvre individuellement et collectivement et qui ne relève pas de l’exécution.» 5.
Les «assurances qualité»
En prime, on observe un peu partout le développement d’«assurances qualité». L’«assurance qualité» est un concept lancé aux Etats-Unis il y a une cinquantaine d’années par les acheteurs du ministère de la Défense, secteur de l’armement. Ce concept s’adressait alors aux fournisseurs et avait pour but la prévention : il s’agissait de s’assurer que les différentes pièces de l’armement étaient conformes aux normes de l’époque, bref qu’elles pouvaient fonctionner sans danger pour l’utilisateur et avec une maximale «efficacité», et c’est ainsi que la première norme de management de la qualité a été produite par l’armée américaine (MIL-Q-9858). De ce standard sont issues les normes ISO 9000.
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) est désormais une fédération mondiale d’organismes nationaux de quelque 130 pays (créée en 1947). Elle se donne pour mission de favoriser le développement de la normalisation et des activités connexes dans le monde, en vue de faciliter entre les nations les échanges de biens et de services et de développer la coopération dans les domaines intellectuel, scientifique, technique et économique. Les normes ISO permettent aux entreprises de mieux gérer la sous-traitance (on est sûr que les pièces produites à moindre coût dans un pays pauvre répondent à différents critères) et la politique du «flux tendu», qui consiste à produire uniquement en fonction de la demande 6.
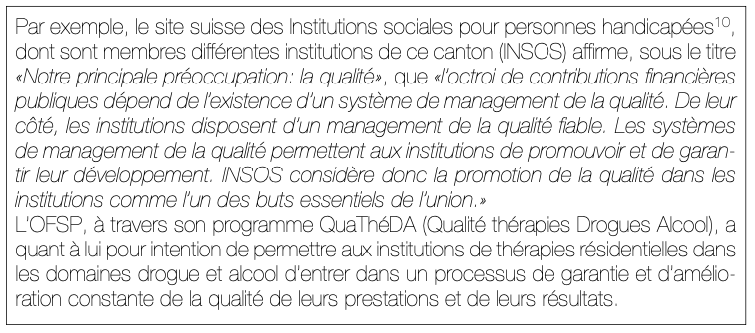
Les normes dites de «qualité» tendent aujourd’hui à s’imposer partout, y compris dans les écoles, les institutions sociales ou éducatives qui veulent (ou doivent) porter un «label» qualité, alors même que ce concept n’a aucun sens dans ce champ. Cette labellisation participe, comme les contrats de prestations, d’un découpage de l’activité humaine en autant de segments qu’il est nécessaire pour la faire ressembler au modèle économique dominant. Elle instaure un rapport de clientèle, d’offre et de demande, bref un rapport marchand dans la sphère non marchande.
Ces politiques changent fondamentalement le travail social et éducatif et instituent de nouveaux rapports sociaux. Elles sont en rupture avec les principes qui organisaient le travail social ou éducatif. L’introduction de ces normes change le type de travail social effectué, mais il le fait subrepticement, sans s’y affronter de front: personne ne dit que le métier doit changer, mais un changement s’impose, conforme à l’orthodoxie économique du moment, par le biais de normes de type administratif et bureaucratique.
Conclusion
L’on peut donc se demander si ce n’est pas, par certains côtés en tous les cas, un nouveau travail social qui se dessine, basé sur une vision nouvelle des problèmes et des solutions à apporter et sur de nouveaux types de professionnels. Ce nouveau travail social émergeant doit être questionné dans ses fondements et ses conceptions d’autant plus fortement qu’une nouvelle hiérarchisation des professions sociales se dessine.
Dès 2002, les experts du social et de la santé seront formés dans les HES. En parallèle, de nouvelles formations moins qualifiées se mettent en place: des apprentissages, comme celui de «sociagogue (accompagnateur/trice de personnes âgées)» 7 qui vient de débuter; de nouveaux «apprentissages sociaux» 8 (3 ans), qui s’introduisent en Suisse alémanique aujourd’hui; les apprentissages d’«opérateur socio-assitanciel» 9, option aide familiale ou option institution sociale, qui se développent au Tessin (2 ans de formation), ou encore les maturités professionnelles en projet dans les domaines de la santé et du travail social.
Le risque est grand que certaines des «prestations» désormais codifiées, labellisées et simplifiées des travailleurs sociaux soient bientôt elles aussi «externalisées» et données à effectuer à des personnes moins bien formées, moins qualifiées et moins rémunérées, au plus grand dommage des bénéficiaires devenus, bien malgré eux, des «clients».
- Voir Leimgruber Matthieu (2001), Taylorisme et management en Suisse romande (1917-1950). Lausanne: Antipodes.[↑]
- Voir Guex Sébastien (1998), L’argent de l’Etat. Parcours des finances publiques au XXe siècle. Lausanne: Réalités sociales.[↑]
- Voir Keller Véréna, Tabin Jean-Pierre (2002), La charge héroïque. Missions, organisations et modes d’évaluation de la charge de travail dans l’aide sociale en Suisse romande. Lausanne : Cahiers de l’EESP.[↑]
- Knoepfel Peter (1995), Le New public Management: Est-ce la panacée? Revue suisse de science politique 1(4), 130-138.[↑]
- Dejours Ch. (1998), Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale. Paris: Seuil.[↑]
- Paugam S. (2000), Le salarié de la précarité. Paris: PUF.[↑]
- Règlement N° 94302 du 2 mai 2001.[↑]
- Soziale Lehre.[↑]
- Operatori socioassitenziali.[↑]
